Le centre ville remarquable

Vieille ville : secteur sauvegardé de 65 ha
Vivant, très actif, il permet « balade shopping », « balade culturelle » (hôtels particuliers) et « balade détente » (5 salles de cinéma).
Saint-Germain-en-Laye, ville commerçante
800 commerces sont implantés en grande majorité au cœur même du centre-ville ancien : un chiffre remarquable qui fait de Saint-Germain-en-Laye «le plus grand centre commercial à ciel ouvert de l'ouest parisien». À noter en particulier un secteur alimentaire important et une activité hôtelière, restauration très bien représentée.
Le marché de Saint-Germain-en-Laye, se tient place du Marché Neuf, les mardi et vendredi de 8h30 à 13h et le dimanche de 8h30 à 13h30.
À ne pas rater :
Les maisons à arcades de la place du Marché, maisons bâties au début du XIXe siècle. Place typique et très animée, commerces, et marchés plusieurs fois par semaine.


Le vin des grottes

Deux communes à l'initiative
Les communes de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq décident en 1999 de replanter et d’exploiter des vignes sous la Terrasse de Saint-Germain-en-Laye afin de restituer à ce site sa vocation historique et permettre de reconstituer la perspective de la Terrasse vers Paris, telle que l’avait imaginé Le Nôtre. En avril 2000, les deux communes plantent 1820 pieds de vignes sur 2000 m² et renouent avec plus de treize siècles d’histoire.

Cette culture remonte au VIIIe siècle
Pour s’inscrire dans la tradition, le premier geste de nos élus fut de faire porter symboliquement nos premières bouteilles à l’abbaye de Saint Wandrille en Normandie. La tradition s’est maintenue jusqu’en 1935, date de la dernière récolte et de la dernière fête des vignerons. Cette vigne mêle deux variétés issues d’un cépage de pinot noir qui produit un vin de type bourgogne. Les atouts du terroir ne manquent pas : exposition à l’est, bon ensoleillement et microclimat, terrain suffisamment argileux pour avoir un vin rouge de qualité et suffisamment calcaire pour obtenir un vin fin et élégant.
La plantation de ces vignes a été réalisée avec l’assistance technique d’un viticulteur œnologue aidé par le lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye.
De la première vendange en 2001 où trois petites grappes par pied de vignes font récolter 50 kilos de raisin soit 25 litres de vin, dix ans plus tard en 2011 la vigne produit entre 800 et 1000 litres de vin.

En 2009, c’est un vin au potentiel très intéressant avec un bel équilibre en bouche, une belle intensité. Sur le plan aromatique, le vin est encore assez fermé même si on peut percevoir des arômes fins et délicats, fruités et floraux.
En 2010, c’est un millésime de belle qualité, ni levuré, ni chaptalisé. Il offre un fruité généreux et une belle concentration. Élevé uniquement en cuve inox, sans boisage, il va exprimer sans détour les qualités de finesse du pinot noir et du terroir du pied de la terrasse.
Les vendanges :
une animation pédagogique et festive
Des enfants des deux communes accompagnés d’adultes : parents, œnologues, jardiniers, le président intercommunal, les maires des deux communes, et des élus assurent une partie des vendanges. Tous les adultes se retrouvent ensuite pour une première dégustation. (Ce vin ne peut être vendu.)
La fontaine de la Pissotte

La fontaine doit son nom et sa fortune à Guillaume de la Pissotte, un des officiers de la reine Blanche de Castille, qui possédait une propriété sur ce versant, acquit la source et mit son eau en faveur à la cour.
La fontaine des Pieds pourris
Au Moyen-Âge, elle était appelé « fontaine des pieds pourris » parce que les voleurs étaient condamnés à rester les pieds attachés sous l’eau très froide de la fontaine jusqu’à ce que leurs membres accusent des signes de pourriture.

La fontaine des rois, de St-Louis à Louis XIV
La mère de Louis IX (Saint-Louis), qui la trouvait saine et légère, n’en voulait point d’autre pour sa table, et tous les jours, les gens de service allaient y puiser celle qui était nécessaire à la consommation de la reine et des personnes de sa suite.
La fontaine de la Pissotte a longtemps conservé sa réputation et son excellente eau limpide fut très appréciée pendant plusieurs siècles à la Cour de France qui résidait souvent à Saint-Germain-en-Laye. La tradition perdura même lorsque le roi Soleil quitta Saint-Germain-en-Laye pour Versailles et l’eau de la source y fut transportée dans des bouteilles en plomb.
Aujourd'hui...
La Fontaine de la Pissotte est dissimulée derrière un mur fermé par une porte et n'est pas visible de la rue. C'est une propriété privée qui est ouverte occasionnellement ou lors des Journées du Patrimoine.
Pour toute demande de visite en petits groupes, contacter l’Office de Tourisme :
01 30 87 20 63
info@ot-saintgermainenlaye.fr



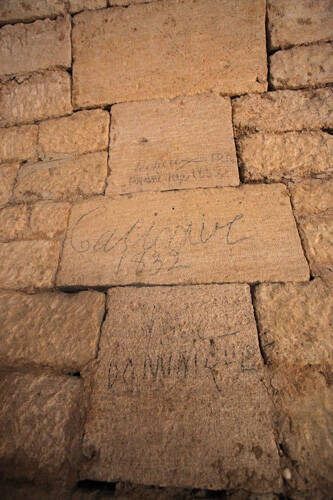
Le fort Saint-Sébastien, camp d’entraînement
des troupes de Louis XIV
De 1669 à 1671, une immense parcelle (28 ha), au nord de la forêt de Saint-Germain, a accueilli le fort Saint-Sébastien, un camp d’entraînement des troupes de Louis XIV.
“C’est la première fois en Europe qu’on fait une telle découverte”, prévient Séverine Hurard, responsable scientifique des fouilles conduites actuellement par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

Une découverte inédite
Édifié en 1669, le fort Saint-Sébastien est un quadrilatère de 600 m sur 380 m. Il s’agit d’une fortification de terre, avec des fossés, des talus et des palissades. L’objectif de cette construction est de permettre de simuler le siège et la prise de places fortes.

30 000 soldats et 5 000 chevaux
Les archéologues ont réussi à sortir de terre des objets (céramiques, verres à pied décoré, dés à jouer, pipes en terre cuite, pièces de monnaie, pots en terre pour cuisiner, boutons…) qui révèlent les modes de vie et d’alimentation des soldats et les types d’approvisionnement de l’armée royale.
“Toutes ces découvertes témoignent de l’intense vie quotidienne de ce camp militaire qui était aussi rythmée par les approvisionnements en viandes, céréales, foin…” souligne Séverine Hurard
Commencées en octobre 2011, les fouilles représentent une enveloppe d’environ 7 millions d’euros financés par le SIAAP et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.




